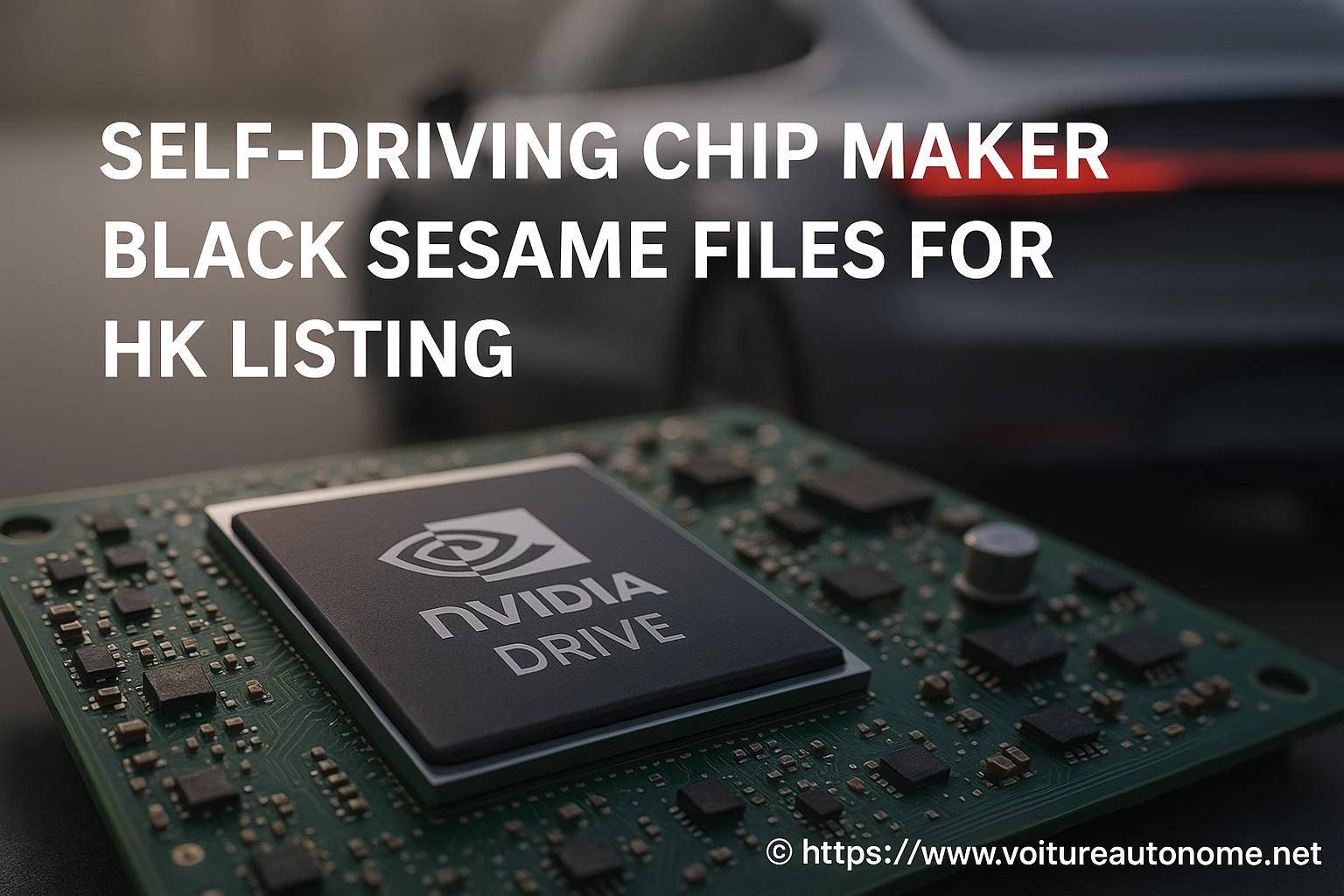Législation en matière de véhicule autonome
Les chauffeurs de taxi ne sont pas les seuls freins potentiels au développement du véhicule autonome. La législation, véritable colonne vertébrale qui structure nos sociétés modernes, sera elle aussi l'un des paramètres essentiels susceptibles de ralentir la mise en circulation de la voiture autonome.

Aujourd'hui, alors que les laboratoires d'innovation rivalisent de créativité et que les rues de certaines villes voient déjà circuler ces véhicules du futur, la législation actuelle risque fort de paraître très vite dépassée, tel un gardien figé devant une porte que l'on a déjà ouverte ailleurs.
Législation et voiture autonome
Face à cette transformation technologique et sociale qui s'annonce, il devient indispensable de s'interroger sur le rôle de la loi et des autorités de régulation. Car si la technologie avance à pas de géant, la législation, elle, ressemble davantage à un paquebot : elle doit concilier de nombreux intérêts, veiller à la sécurité de tous et parfois, s'adapter en urgence à des situations inédites.
« Une législation adaptée, c'est la promesse d'une route partagée entre l'innovation et la sécurité. »
Aussi, pour éviter tout risque de dérive ou de dérapage - au sens figuré comme au sens propre - il semble plus sage d'adopter dès à présent des nouvelles lois adaptées aux voitures sans chauffeur. Il s'agit notamment :
- de définir précisément les responsabilités en cas d'accident,
- d'encadrer l'utilisation des données générées par les voitures autonomes,
- d'assurer la cybersécurité face aux risques de piratage,
- et de garantir l'accessibilité et l'inclusion au plus grand nombre.
Pour aller plus loin et mieux comprendre les défis juridiques, nous relayons dans les paragraphes ci-dessous les actualités concernant la règlementation en vigueur en France ainsi que l'évolution des législations à l'échelle mondiale. Cette exploration permettra d'illustrer comment divers pays, chacun à leur manière, tentent de dresser la carte du nouveau territoire de la mobilité autonome.
- La législation est un catalyseur essentiel du développement de la voiture autonome, autant qu'un possible frein selon son adaptation.
- Son objectif principal demeure la préservation de la sécurité des usagers et la protection des droits individuels.
- L'évolution réglementaire accompagne et structure les avancées technologiques.
La France franchit le cap et autorise l'essai de voiture autonome
Après le conseil des ministres du 3 août 2016, la France a fait un pas décisif en autorisant, via une ordonnance, le premier essai des voitures autonomes sur les routes nationales. Les expérimentations des « voitures à délégation de conduite » étaient alors inédites en France, symbolisant une avancée vers la transformation de l'industrie du transport.
"Les véhicules autonomes sont une étape incontournable vers une mobilité apaisée, une régulation et une sécurisation des trafics, et des transports plus efficaces et plus respectueux de l'environnement" et "constituent l'avenir de l'industrie automobile."
Ce positionnement institutionnel illustre la volonté d'inscrire l'autonomie des véhicules comme une pierre angulaire du futur de la mobilité. Mais, au-delà des innovations, la question de la sécurité routière reste centrale : comment garantir que ces véhicules, capables de décider, d'accélérer, de freiner seuls, anticipent mieux, voire évitent les erreurs humaines ?
Lors de ce conseil des ministres, la sécurité a été évoquée comme une condition sine qua non à l'expérimentation. En effet, le fait que la voiture soit totalement indépendante sans conducteur pourrait abaisser le taux d'accidents sur la route. Les causes humaines majeures d'accidents (alcool, fatigue, distraction, incompétence) seraient considérablement réduites, voire éliminées.
- Exemple concret : Sur une autoroute, un conducteur humain peut facile se laisser distraire par son téléphone ou la fatigue. Une voiture autonome équipée de systèmes d'intelligence artificielle et de capteurs de dernier cri détectera instantanément toute anomalie et maintiendra le cap, indépendamment de l'état de son «occupant».
- Autre situation : En cas de freinage d'urgence, où chaque milliseconde compte, les véhicules autonomes peuvent communiquer entre eux via des réseaux V2V (Vehicle to Vehicle), anticipant un freinage massif en chaîne et évitant ainsi la réaction en retard typique d'un être humain surpris.
Cependant, il faut reconnaître que la mise en œuvre de ces premiers essais a été complexe, en raison de la rigidité des règles internationales du code de la route en vigueur. L'homologation, la circulation interopérable entre véhicules autonomes et traditionnels, la cohabitation sur l'espace routier... chaque étape nécessite de nombreuses précautions et une adaptation fine du droit.
Un exemple parlant est celui de la nécessité d'un «conducteur prêt à reprendre les commandes» imposé lors des premières expérimentations, sorte de filet de sécurité transitoire. Depuis lors, la loi évolue régulièrement pour accompagner la montée en autonomie précisément des véhicules.
- En France, les expérimentations sont aujourd'hui ouvertes à tous types de véhicules et dans différents contextes urbains, suburbains ou ruraux.
- La stratégie nationale pour le développement des véhicules automatisés prévoit un cadre progressif autorisant la circulation de véhicules à délégation totale de conduite dans certaines conditions, sous réserve d'agrément.
Malgré toutes ces avancées, un aspect crucial demeure encore insuffisamment abordé : la cybersécurité. Les risques de piratage, s'ils ne sont pas anticipés, pourraient transformer ces prodiges technologiques en proies vulnérables sur la route. Ainsi, la règlementation française et européenne continue d'évoluer pour intégrer des normes strictes de sécurité informatique. Par exemple, depuis peu, l'homologation d'un véhicule autonome requiert la preuve de dispositifs de protection contre l'accès non autorisé aux systèmes embarqués. [ Voir ici aussi ]
Qu'en est-il de la loi au niveau international ?
L'un des principaux obstacles à la généralisation du véhicule autonome à l'échelle mondiale reste la diversité des législations nationales. Certaines règlementations, héritées du siècle dernier, imposent encore que le conducteur garde deux mains sur le volant pendant la conduite. C'est le cas notamment de la Convention de Vienne sur la circulation routière, dont l'application stricte freine l'essor de la conduite automatisée dans de nombreux pays.
- En Allemagne, la loi permet la circulation de voitures à délégation de conduite sous certaines conditions, à condition qu'un conducteur puisse «reprendre le contrôle à tout moment».
- Aux États-Unis, la Californie, l'Arizona et d'autres États ont autorisé dès 2015 la circulation de véhicules autonomes pour des essais sur la voie publique. Des entreprises comme Waymo ou Tesla y roulent déjà sans passager humain.
- Au Japon, des taxis autonomes expérimentaux circulent dans Tokyo, encadrés par des lois spécifiques sur la responsabilité et la gestion des incidents.
- En Chine, plusieurs grandes villes (Pékin, Chongqing, Wuhan) ont ouvert leurs voiries à des tests de robotaxis, en partenariat avec des industriels locaux et internationaux.
Afin de contourner les freins règlementaires, certains gouvernements ont pris l'initiative de voter des ordonnances, comme ce fut le cas en France, autorisant la mise en circulation de la voiture autonome sur la voie publique dans le cadre de tests. Cette démarche progressive permet d'évaluer les conséquences concrètes, tout en adaptant petit à petit le droit aux enjeux nouveaux.
- Certains pays, comme la Norvège ou la Suède, misent sur des «zones blanches» où la règlementation ordinaire s'efface pour laisser place à des expérimentations majeures de mobilité autonome.
- L'Europe, de son côté, encourage l'harmonisation progressive des standards, pour éviter la fragmentation du marché intérieur.
- Des organismes internationaux, tel que l'UNECE (Commission économique des Nations Unies pour l'Europe), travaillent à l'élaboration de règles transfrontalières sur la sécurité et l'interopérabilité des systèmes autonomes.
Aujourd'hui, ce sont essentiellement des tests qui sont menés, qu'il s'agisse de voitures autonomes à délégation totale de la conduite ou de véhicules semi-autonomes à délégation partielle. Nombre de ces expérimentations visent à préparer le terrain à une commercialisation de masse, en testant la robustesse des technologies mais aussi, et surtout, l'acceptabilité sociale des véhicules sans conducteur. Ce sont de véritables laboratoires à ciel ouvert, où la réglementation se construit en même temps que la technologie se perfectionne.
Ainsi, l'ordonnance votée lors du conseil des ministres en France, et d'autres textes équivalents dans le monde, "servira de fondation à la construction d'un cadre réglementaire solide au travers d'un décret en Conseil d'État". Pour les entreprises qui souhaitent commercialiser leurs voitures sans chauffeur sur le territoire national, cette adaptation réglementaire apporte une prévisibilité juridique bienvenue. Le risque de retard technologique s'en trouve limité, et la confiance des usagers peut s'établir plus aisément.
Quels sont les enjeux concrets de la législation autour de la voiture autonome ?
- Responsabilités en cas d'accident : Qui est responsable en cas d'accident entre un véhicule autonome et un autre usager ? Le propriétaire du véhicule, le constructeur, le fournisseur du logiciel, ou un tiers ?
- Normes de sécurité : Quels standards de performance et de sécurité doivent respecter les véhicules autonomes ? Faut-il imposer un «permis de conduite» aux intelligences artificielles ?
- Gestion des données : Comment protéger la vie privée des utilisateurs et sécuriser les énormes volumes de données collectées par les voitures autonomes (itinéraires, vidéos, comportements, etc.) ?
- Intégration urbaine : Comment adapter les infrastructures existantes (signalisations, routes, parkings, feux tricolores intelligents...) pour faciliter la cohabitation entre véhicules traditionnels, autonomes et autres modes de déplacement ?
- Inclusion sociale : Quels mécanismes garantir que ces innovations profitent à tous et ne creusent pas de nouvelles inégalités (personnes âgées, handicapées, zones rurales...) ?
Ces points sont aujourd'hui largement débattus au sein des parlements nationaux, dans des groupes de travail réunissant juristes, ingénieurs, urbanistes et sociologues. En France comme ailleurs, l'accent est mis sur une adaptation progressive, pragmatique, associant phases d'expérimentation et consultations publiques.
Vers un avenir régulé et partagé
Si la route vers la voiture autonome peut être comparée à une course de relais, chaque acteur - industriel, législateur, usager - doit passer le témoin à l'autre pour que l'innovation atteigne sa pleine maturité. La législation, loin d'être un simple frein, est une boussole indispensable qui indique le cap à suivre entre progrès technologique et préservation du bien commun.
En conclusion, l'arrivée de la voiture autonome bouleverse autant la technique que le droit, transformant à la fois nos modes de déplacement et notre rapport aux responsabilités individuelles et collectives. Le pari est de trouver un équilibre sain, résolument tourné vers l'avenir, où la sécurité et l'innovation pourront cheminer main dans la main, dans l'intérêt de tous.
👉 Lire aussi: Tesla autonome